La force de l’interculturel
Des vidéos courtes et pratiques disponible chaque jour ainsi que des outils pour vous permettre de developper votre charisme et votre leadership
Il était une fois… un vieil homme, assis à la porte d’une ville.
Un jeune homme s’approche de lui : « Je ne suis pas d’ici, je viens de loin ; dis-moi, vieil homme, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? »
Au lieu de lui répondre, le vieillard lui renvoie la question : « Et dans la ville d’où tu viens, comment les gens étaient-ils donc ? »
Le jeune homme aussitôt, sur un ton plein de hargne : « Ils étaient égoïstes et méchants, au point qu’il m’était impossible de les supporter plus longtemps ! C’est pourquoi j’ai préféré partir ! »
Le vieillard avec beaucoup de compassion dans la voix : « Mon pauvre ami, je te conseille de passer ton chemin, les gens d’ici sont tout aussi méchants et tout aussi égoïstes ! »
Un peu plus tard, un autre jeune homme s’approche du même vieillard et s’adresse à lui d’une manière très affable : « Salut, ô toi qui es couronné d’ans ! Je débarque en ces lieux ; dis-moi, comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? »
Et le vieil homme de le questionner à son tour : « Dis-moi d’abord, là d’où tu viens, comment les gens étaient-ils ? »
Le jeune homme, dans un grand élan plein d’enthousiasme : « Ils étaient honnêtes, bons et accueillants ! Je n’avais que des amis ; oh que j’ai eu beaucoup de peine à les quitter ! »
Le vieillard dit alors : « Eh bien, ici également, tu ne trouveras que des gens honnêtes, accueillants et pleins de bonté. Sois le bienvenu ! »
Un marchand faisait boire ses chameaux non loin de là, et il avait tout entendu :
« Comment est-il possible, ô vieil homme que je prenais pour un sage, de donner, à la même question, deux réponses aussi diamétralement opposées ? »
« Mon fils, déclara le vieil homme, chacun porte en son cœur son propre univers et le retrouvera en tous lieux. Sauf s’il ouvre son cœur. Alors son regard sur les autres et le monde sera changé. »
Conte « Le vieux sage et le marchand ».
« L’étranger est un ami que l’on ne connaît pas encore. » Proverbe irlandais. Cliquez pour tweeterL’étranger est un ami que l’on ne connaît pas encore. Proverbe irlandais.
Interculturalité et visions du monde
Et vous alors ? Tel que ce marchand spectateur, que pensez-vous de la réponse du vieux sage ?
- Pour aborder l’autre, faut-il rester dans notre vision du monde et dans nos clichés ?
- Quel regard faut-il adopter ?
Nous allons aller chercher des réponses dans un nouvel ouvrage, consacré à l’interculturalité, qui vient d’être publié en avril 2022, aux Editions Charles Léopold Mayer, par Philippe Pierre et Michel Sauquet : L’Archipel humain. Vivre la rencontre interculturelle.
Philippe Pierre, que j’ai eu la chance de recevoir pour une rencontre du Club APM Suellaba de Douala il y a quelques semaines, a eu l’amitié de m’envoyer quelques éléments sur ce nouvel ouvrage. Nous les retrouvons ci-dessous.

Philippe Pierre et Bernard Guévorts
L’article qui suit est proposé par Philippe Pierre et Michel Sauquet ; les titres et l’introduction sont notre contribution.
La voie de l’interculturalité
Dans un monde en tumulte, nous voulons explorer une voie exigeante qui est celle de l’interculturalité et qui défend un optimisme de combat, comme aimait à le dire Michel Serres. Cette voie, c’est celle des relations croissantes entre des êtres d’abord étrangers les uns aux autres, parfois suspicieux, souvent intrigués ou curieux et qui parviennent à trouver un terrain d’entente. Et même plus, d’enrichissement mutuel.
Cette voie est celle, pour nous, de la rencontre interculturelle qui sera toujours une victoire sur l’inaction et sur toutes les formes d’ostracisme. C’est celle du progrès humain. Et l’on ne peut réduire le dialogue interculturel à une simple manœuvre idéologique consistant à légitimer l’ordre en place.
Ce combat débute d’abord en chacun d’être nous. Se familiariser avec une autre culture demande du temps et une énergie facilitant l’empathie. Les crises sanitaires, économiques et environnementales que nous connaissons actuellement nous obligent, en effet, à vivre l’incertain et aussi à nous garder de tout dogmatisme, de toute classification simpliste.
Un et multiple
Ces crises nous amènent à nous interroger sur ce qu’est l’être humain, trop souvent catalogué comme simple membre d’une nation, comme femme ou homme, comme immigré ou « de chez nous », comme ingénieur, technicien ou paysan, comme jeune ou vieux, riche ou pauvre, instruit ou analphabète.
Or, la personne humaine est souvent elle-même, multiple, intérieurement divisée peut-être, n’ayant plus une mais deux, trois ou dix communautés d’appartenance au fil de son histoire de vie, alors même qu’elle n’a pas forcément beaucoup voyagé…. Communautés numériques, vies sentimentales, alliances de voisinage, proximités dans la sphère du travail, pratiques religieuses… font leurs effets et certains individus semblent avoir plus de possibilités qu’il y a cinquante ans d’afficher leur fidélité à des racines, à des cultures, à une mémoire rappelant leurs origines (ce qui est illustré notamment par le choix des prénoms donnés aux enfants (1)).
Une autre attitude
Notre ouvrage discute de l’hypothèse que certains individus, tout simplement, et plus qu’au début du siècle dernier, se comportent différemment dans des contextes différents !
Autour de nous, les chercheurs français ont davantage écrit sur l’acculturation, le social à l’état incorporé (habitus), l’historicité des classes sociales que sur le bricolage, la sortie des déterminismes, sur la diversité des destins sociaux et de ces affiliations multiples qui affectent un « homme pluriel » (2).
Depuis longtemps, dans nos écrits, plutôt qu’à une logique d’inventaire et d’invariants culturels supposés, nous préférons explorer l’expérience des « métisseurs » (3). Et ceci particulièrement dans les états de crise et de remise en cause forcée de leurs habitudes qu’occasionnent les déplacements physiques.
C’est ce mouvement de multiplication des appartenances culturelles que nous voulons mieux saisir, comprendre et même défendre en affirmant que les mises en contact avec des personnes mobiles ou immigrées sont une grande chance pour nos nations.
Les notions explorées
Dans cet ouvrage, nous nous expliquons sur l’utilisation des concepts de culture et d’interculturel, prenons nos distances avec celui de diversité, qui nous paraît flou, abstrait et polysémique, explorons quatre approches du traitement des différences (mono, multi, inter et transculturelle), discutons de l’opportunité ou pas des quotas pour davantage de justice.
Nous condamnons l’utilisation de quotas fondés sur l’origine pour la société française mais comprenons ceux fondés sur le genre, et encourageons ceux sur la situation de handicap ou l’âge. Nous préférons au mot de différence celui d’écart culturel, plus dynamique et plus proche d’une vérité humaine en épaisseur qui s’accommode mal des oppositions, des typologies, des stéréotypes et des classements en tiroirs culturels.
Si l’on ne peut nier l’existence et la force d’« adhérences » françaises, tchèques ou chinoises, l’influence de cultures de métiers, d’origine sociale ou de générations, la personne humaine reste un archipel, aux caractéristiques perpétuellement changeantes au fil de vies de plus en plus mobiles et sous l’influence de multiples brassages, et même, de créolisations. Appréhender le monde ainsi peut éviter de suivre l’appel des prophètes du malheur, des professionnels du déclin et de tout extrémisme. Envisager cette part propre à la personne dans un élan collectif peut aussi revivifier un imaginaire politique progressiste.
Suspendre son jugement
L’ouvrage promeut l’expérience du doute, la distanciation du regard et la suspension du jugement.
Cultures et identités peuvent faire bon ménage à la condition de savoir s’ouvrir à ce que nous nommons, depuis quelques années, une « intelligence de l’autre ». La seule bonne volonté de comprendre ne suffit pas et lorsqu’une travailleuse sociale reçoit un immigré africain ou asiatique d’origine rurale, il faut un savoir-faire. Parler dans la langue de l’autre en est une magnifique expression.
Les temps contemporains conduisent à un fric-frac identitaire puissant qu’il s’agit de comprendre parce qu’ils redéfinissent le sens même de la notion de culture. Lier les deux notions de culture et d’identité, comme nous le faisons dans ce livre, revient à chercher cette possibilité, chère à Edouard Glissant, de changer en échangeant avec l’Autre sans se perdre pourtant, ni se dénaturer.
« Changer en échangeant avec l’Autre sans se perdre pourtant, ni se dénaturer. » Edouard Glissant Cliquez pour tweeterS’interrogeant sur les grands enjeux culturels de notre époque – laïcité, prise en compte du facteur culturel dans le management des entreprises et des associations, égalité des chances, lutte contre les discriminations, influence des langues la formation de la pensée, etc. – nous proposons, dans cet ouvrage, des pistes pour une nouvelle intelligence interculturelle pour s’adapter aux réalités d’un monde qui ne reste pas en place et suppose d’admettre et de pratiquer l’étonnement volontaire.
Qu’est-ce que l’étonnement volontaire
D’après le livre de Philippe Pierre, Le livre du manager : Clés d’un management efficace et intégrant. Et également explication donnée lors de la rencontre avec le Club APM Suellaba à Douala le 11/01/2022.

L’étonnement volontaire dans le recrutement
Attention au piège du « flair » ou du « coup de cœur ».
Faut-il toujours se fier à sa bonne première impression ? Certes non.
Méfiez-vous de votre première impression, quand le candidat rentre dans votre bureau ou s’approche lors d’un forum de recrutement. Ne donnez pas trop la possibilité à cette « première impression » de se diffuser dans ce qui va suivre, comme un gaz qui inonde une pièce !
L’important est de favoriser des entretiens d’exploration et de lutter contre les effets négatifs des entretiens de confirmation où l’on court le risque de s’obstiner à chercher toujours les mêmes qualités chez les mêmes candidats. Surtout si l’on est pressé et que le poste est vacant depuis longtemps !
Si l’on n’a pas changé d’avis, au moins une fois, sur un candidat lors de l’entretien de recrutement (45 minutes), prenons-le comme un point de vigilance ou d’amélioration.
- Peut-être est-on en train de confirmer plutôt que d’explorer ?
- Peut-être veut-on absolument confirmer une bonne première impression faite par le candidat qui n’est pas forcément la bonne personne au final ?
La loi du « magnétisme » en management veut que ceux que vous attirez sont conformes à ce que vous êtes !
Les candidats interrogés peuvent aisément donner des réponses préparées à l’avance. Face à eux, les recruteurs, dans un scénario bien huilé mais peu fécond, choisissent souvent les candidats dont ils partagent les manières de faire ou d’être plutôt que ceux qui ont le plus fort potentiel. De même, les candidats séduisants ne sont pas forcément les meilleurs, mais nous supposons inconsciemment qu’ils le sont ou qu’ils le seront.
Explorer plutôt que confirmer lors de l’entretien, notamment en reformulant !
Et en pratiquant la règle du 20/80. 80 % du temps à la parole du candidat. 20 % à la vôtre !
Pratiquez donc l’étonnement et la curiosité volontaire !
L’Archipel Humain
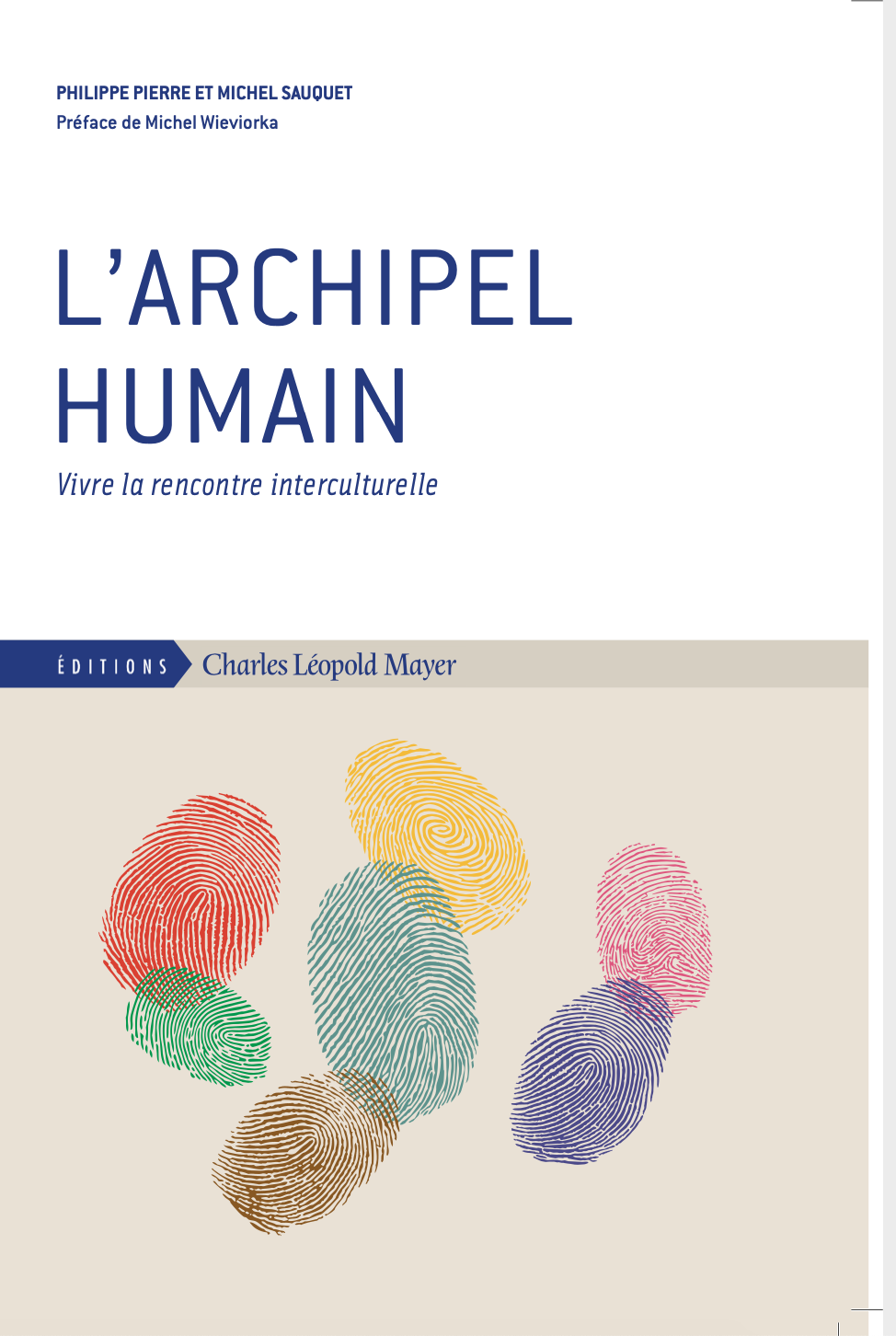
A travers ce livre, l’Archipel Humain, Philippe Pierre et Michel Sauquet, nous proposent de vivre une sortie de soi. De se décentrer pour devenir disponible à autrui.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Les questions du coach
- De quelle manière allez-vous suspendre votre jugement ?
- Et dans quelles situations ?
- Quelles découvertes interculturelles avez-vous faites dernièrement ?
- Qu’avez-vous appris et mis en pratique suite à la rencontre interculturelle ?
Bibliographie :
1. Gérard Noiriel, Le venin dans la plume, La Découverte, pp. 157-158. Trouvant du « jeu » chez l’individu, Georges Devereux a ainsi parlé de notre « différenciabilité » individuelle comme le fait que nous possédions une pluralité d’identités significatives dont nous ne pouvons nous priver et avec lesquelles nous bricolons (Georges Devereux, « La renonciation à l’identité : défense contre l’anéantissement », Revue Française de Psychanalyse, I, 1967, pp. 101-141).
2. Bernard Lahire, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Armand Colin, 1998.
3. Philippe Chanson, Variations métisses Dix métaphores pour penser le métissage, Éditions Academia, 2011, p. 63.
- L’Archipel humain – Vivre la rencontre interculturelle, Philippe Pierre, Michel Sauquet, Éditions Charles Léopold Mayer, 2022
- Le livre du manager : Clés d’un management efficace et intégrant, Philippe Pierre.
- Un podcast assez large sur le management interculturel
Des vidéos courtes et pratiques disponible chaque jour ainsi que des outils pour vous permettre de developper votre charisme et votre leadership
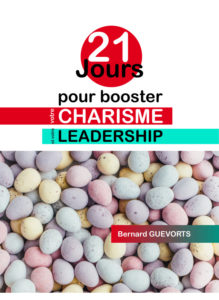
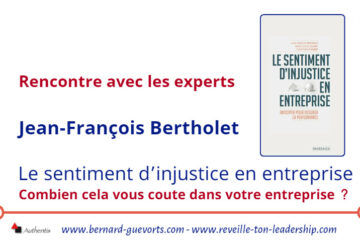
4 commentaires
philippepierre22 · 20 avril 2022 à 10h19
Merci beaucoup Bernard pour cette opportunité de partage sur le management interculturel. Un domaine important pour les organisations, les entreprises et plus largement le continent Africain. Je conserve un excellent souvenir de notre travail au Cameroun pour l’APM et de nos échanges avec Claudélen ! Votre expertise est forte dans les domaines de l’accompagnement tant individuel que collectif de managers et de dirigeants. Votre créativité réelle ! Philippe Pierre
Bernard Guévorts · 20 avril 2022 à 10h29
Merci beaucoup Philippe!
C’était un plaisir de travailler avec toi.
Et merci pour cet article qui inaugure une nouvelle rubrique du blog avec le partage des experts !
A très bientôt !
Maïzouna MERAM · 15 mai 2022 à 11h25
Merci pour cet article portant sur l’inter culturel.
C’est un sujet vaste, intéressant et incontournable de nos jours comme indiqué par les auteurs.
S’intéresser à l’interculturel, c’est faire preuve de curiosité, d’empathie et d’humilité. L’inter culturel est effectivement l’avenir de toute société ou organisation envisageant de progresser dans ce monde qui va si vite.
J’ai beaucoup apprécié l’expression « archipel humain »👍
Bernard Guévorts · 15 mai 2022 à 12h34
Merci pour votre retour et votre appréciation !!!